Pacha
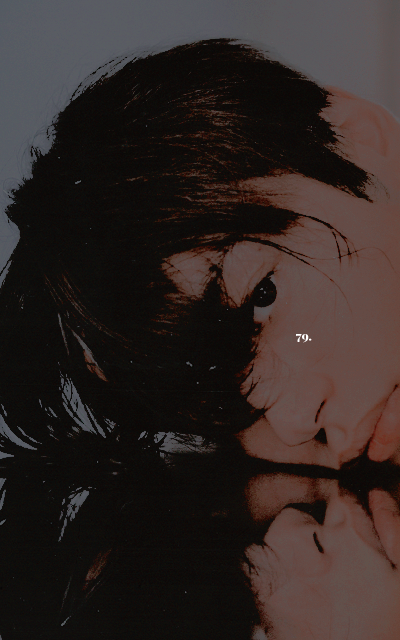
 pseudo : la pau bleue avatar : umi defoort situation : madeleine, caius, anna... ils tournent dans sa tête et ne partent jamais vraiment. (recherche ardemment cette moitié qu'il espère tant). occupation : facteur. Messages : 57
pseudo : la pau bleue avatar : umi defoort situation : madeleine, caius, anna... ils tournent dans sa tête et ne partent jamais vraiment. (recherche ardemment cette moitié qu'il espère tant). occupation : facteur. Messages : 57
pseudo : la pau bleue
avatar : umi defoort
situation : madeleine, caius, anna... ils tournent dans sa tête et ne partent jamais vraiment. (recherche ardemment cette moitié qu'il espère tant).
occupation : facteur.
Messages : 57
Pacha.
Petrograd ;;
22 octobre 1915 ; 05h00.
à @Odile Jankowski, Ksenia.
je regarde mes mains. mes doigts raidis par le froid et la peau qui tire quand je les plie. elle est sèche et pèle par endroits. je regarde les jointures blanchir puis reprendre leur couleur normale, et les plis qui restent ; qui n'arrivent pas à disparaître. je gratte la saleté sous mes ongles. ça me prend du temps. ce n'est pas qu'il y en a beaucoup : c'est que je veux faire ça bien.
nous amorçons un virage. les rails suivent un fleuve dont je ne me souviens plus le nom. ses eaux noires dévalent la pente pour se jeter un peu plus loin, et rejoignent peut-être ma ville natale, saint-pétersbourg, que l'on n'appelle plus ainsi depuis qu'on l'a renommée petrograd. parfois, j'oublie qu'on la nomme autrement, puisque je l'ai toujours connue ainsi : une sainte. c'est à cause de la guerre qu'elle a changé, et j'aimerais lui en vouloir, à la guerre, d'assombrir ainsi питер. mais j'ai entendu dans les rues la sourde colère qui se soulève ; et peu à peu, elle s'est frayée un chemin et a noirci à son tour mon propre cœur.
j'observe les eaux qui sont trop calmes pour être celles de la neva, ce fleuve qui borde la rive de la capitale septentrionale et descend du lac ladoga qui chaque hiver, se recouvre de son manteau marbré. je me rappelle d'un temps où des familles venaient y faire du patin, mais maintenant, les familles, il n'y en a plus : les maris sont morts sur un front lointain et leur veuves s'abîment dans leur chagrin. les enfants, eux, grandissent et ont oublié ce lac où ils furent un jour heureux. certains sont même partis rejoindre leurs pères sur ces terrains boueux, j'ai entendu dire que certains étaient même très jeunes et qu'ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. c'est là que je maudis la guerre, car elle sait très bien ravir les cœurs et elle n'a aucune pitié. elle en redemande toujours plus et j'aimerais savoir si un jour elle sera assez rassasiée ; si un jour elle se terminera, car j'ai peur que bientôt elle ait besoin de moi.
novgorod. la gare n'est éclairée que par de faibles réverbères. j'ai perdu le fleuve de vue. quelques passagers descendent, le dos courbé, l'air fatigué. ils portent leurs valises comme on porte un fardeau. nous redémarrons, et aucun d'entre eux ne lève le visage pour regarder le train partir. je sais désormais que nous sommes encore loin de petrograd. la campagne est plongée dans une obscurité si épaisse que les lumières venant du train ne suffisent même pas à éclairer le bas-côté. et dans tout ce paysage, il y a mon reflet dans la vitre, à travers la crasse qui la macule. des cernes ont creusé mon visage et j'ai l'impression d'avoir vieilli. je n'ai pas dormi ; pourtant, j'avais le temps. je recoiffe mes cheveux gras. les mèches retombent sans cesse devant mes yeux. j'aimerais bien les arranger avant d'arriver.
ça y est, j'ai tout enlevé. je disperse les saletés tombées sur mes genoux. on me prévient qu'on est bientôt arrivés. je me regarde à nouveau. cette fois, j'ai vraiment l'air vieux. ce n'est pas qu'une impression. j'ajuste mon col, enfile mes gants. j'attends que le train s'arrête.
je descends. nous ne sommes pas beaucoup sur le quai, seulement les passagers qui étaient avec moi. je crois que c'est parce qu'il est encore tôt. les aiguilles de la grande horloge indiquent cinq heures treize. tu dois encore être endormie. après tout, la journée commence dans deux heures.
j'avance dans les longs couloirs de la gare. nos pas résonnent dans le silence pesant, alourdi par la fatigue du voyage. nous formons des ombres qui s'évanouissent sous le rideau de pluie qui dégringole sur petrograd depuis plusieurs jours, à ce qu'il paraît. à moscou, il faisait beau, au moins. je m'enfonce dans la nuit épaisse à mon tour. l'air maritime persiste malgré le mauvais temps. ma valise me glisse souvent des doigts à cause du froid qui les tétanise et de l'air poisseux. je pense à mon violon sur mon dos, qui sera tout désaccordé quand j'arriverai à la maison. j'espère que j'aurai le temps de te voir un peu avant que tu partes, avant que je ne m'endorme. je me dépêche, dès lors. mes semelles laissent des traces derrière moi là où le sol est sec, de plus en plus éloignées. je cours, maintenant ; j'aimerais rentrer, embrasser ma femme, et lui dire que je suis enfin arrivé. embrasser ma femme. ils sont combien, les hommes heureux qui peuvent dire cela ?
le métal est glacé. je peine à tenir la clé. je l'insère, pourtant, dans la serrure. tourne en essayant de l'empêcher de faire du bruit. j'entre et dépose mes affaires, guette ton souffle régulier dans la torpeur de notre appartement. je t'entends, ça y est. j'ouvre ma valise. mes chemises pleines de pli surgissent de partout et je les écarte, cherchant à tâtons le paquet qui contient un foulard blanc que je t'ai rapporté de moscou. mes doigts atteignent le papier kraft miraculeusement préservé de l'humidité. je dépose le tout sur la table en espérant que tu l'ouvriras avant de partir au travail. j'enlève mon manteau trempé qui me tenait plus froid que chaud, manque de renverser la chaise sous son poids. je laisse la chaleur me gagner et remarque ton doux parfum qui flotte dans l'air. ces effluves d'été, comme si ta peau avait pris l'arôme du soleil. je l'avais oublié, depuis.
je passe la tête dans l'entrebâillement de la porte qui mène à notre chambre. la pénombre m'empêche de bien te distinguer, je ne vois que ton cou et tes cheveux bouclés relevés en un chignon plein de nœuds. je voudrais courir l'embrasser, mais je me souviens de la crasse qui me recouvre, de mon allure dépenaillée et je me résigne à aller me nettoyer, ne serait-ce qu'un peu, avant de me coucher à tes côtés.
j'ôte mon chandail - lui aussi a pris l'eau. je frissonne, nu face à mon miroir. j'ai maigri, je le vois bien. j'observe les marques nouvelles sur ma peau grise alors que l'eau chauffe. je passe le savon dessus, comme s'il pouvait les effacer. mais je sais bien qu'elles ne vont pas disparaître : la misère, ça n'efface pas d'un coup. je rince mon corps émacié, écarte mes cheveux sales pour en déloger les pellicules qui s'y logent depuis trop longtemps. je reste un moment allongé dans la baignoire, jusqu'à ce que l'eau finisse par refroidir. j'allume une cigarette. tire une bouffée. je ne pourrais, je crois, jamais m'en défaire tout à fait. je laisse la fumée remplir la pièce, puis je me rappelle que tu n'aimes pas ça. ça aussi, j'avais oublié, pardonne-moi. j'écrase le mégot, un peu paniqué, et enfile ma chemise de nuit. le tissu est froid sur ma peau tiède.
je me glisse sous la couverture. son poids me rassure, c'est comme une étreinte. une étreinte chaleureuse pleine de sécurité. les draps sont déjà réchauffés par ta présence. j'avance mon bras pour t'enlacer, mais tu dors si bien que je m'en voudrais de te réveiller. tu es sur le ventre, ton visage tourné vers moi. j'essaye de voir si tu as changé en ces quelques mois, mais il fait trop sombre. j'essaye de t'imaginer. c'est plus difficile que ce que je ne le croyais, maintenant que tu es face à moi. pourtant, ton souvenir ne me quittait jamais vraiment quand j'étais là-bas, et ça m'attriste ; je voudrais qu'il fasse jour maintenant, et que je puisse te retrouver, pour de vrai.
j'ai fini par m'endormir sans m'en rendre compte. j'ouvre les yeux et contemple le soleil inonder la pièce. j'en déduis qu'il est presque midi et que tu es déjà partie. le matelas et les couvertures ont encore tes formes et je regrette de n'avoir pas pu te dire au revoir. en me levant, je remarque que tu as déballé le paquet et que le foulard n'est plus là. je souris en t'imaginant le porter.
j’ouvre la fenêtre, le loquet coince et la peinture s’est écaillée à cause du mécanisme. le bruit de la ville résonne dans la pièce exiguë qui nous sert de cuisine, le froid s’engouffre et m’effleure comme s’il voulait me prévenir que l’hiver allait arriver, car déjà l’automne est parti : toutes les feuilles sont tombées en quelques jours. des balayeurs nettoient le trottoir où elles s’entassent, font des piles qui finiront tôt ou tard par se disperser. je regarde le mouvement de la foule et me demande à quelle heure tu rentreras. il me semble que c’est vers dix-neuf heures, mais cela a peut-être changé depuis. je me souviens, quand nous rentrions ensemble, avant. quand je t’attendais au carrefour de la boucherie chevaline et que nous étions tous les deux effrayés par la terrible vitrine. à moins que ce ne soit toi qui m’attendais, je ne sais plus - j’aurais aimé que ce soit moi. tu avais toujours un goûter avec toi et ta mère ne voulait pas que tu m'en donnes, mais nous partagions toujours car je n'avais jamais rien à manger. il y avait aussi ce petit bijoutier à l'angle de la rue. oh, ce n'était pas la plus belle des boutiques mais j'avais souvent regardé à l'intérieur. j'avais déjà remarqué cette petite alliance, en or, toute simple. on l'aurait dite d'occasion mais à force de l'observer il était évident qu'elle n'avait jamais été portée. le prix aussi, je l'avais retenu. neuf-mille roubles. cinq-cent en plus si on gravait l'intérieur. je m'étais dit que si je me passais de goûter pendant trente ans j'aurais peut-être un jour assez.
je regarde dans mon porte-monnaie. dix-mille roubles. probablement le double d'ici la fin de la tournée. je pourrais, après cela, l'acquérir. j'irai voir s'ils peuvent me la mettre de côté, d'ici que je revienne. même si personne ne l'a jamais réclamée - c'est celle-là que je veux te donner. mais ça voudrait dire que je devrais repartir. un mois, deux, trois, ça dépendra. encore une fois. mais l'absence. est-ce qu'on pourra la supporter ? est-ce qu'on saura toujours s'attendre ? s'aimer de nouveau, comme les premières fois ? parfois je me demande si nous nous sommes un jour trouvés : c'est vrai, ça fait des années qu'on se quitte pour, soi-disant, mieux se reconquérir.
je ne te le dis pas, mais il arrive que je ne rentre pas directement après certaines tournées. je reste chez des amis, passe même voir mes parents, je ne sais pas, je tue le temps. j'ai peur de te trouver dans les bras de quelqu'un d'autre ; en fait non, j'ai surtout peur que tu finisses par te lasser du vide que je laisse derrière moi et que tu ne me permettes plus de rester à tes côtés. parce qu'un amant c'est pas grave, mais m'empêcher de t'aimer comme je le fais, en pointillés, que tu ne veuilles plus de cette histoire d'amour qui a démarré trop tôt et n'arrive pas à se terminer... je le sais, c'est égoïste mais ksenia, il y a une chose dont je suis sûr : c'est que ma femme, c'est toi. et je m'en fous que personne ne le sache : moi, je voudrais qu'on se le promette, que même si on ne se voit plus on sera toujours ensemble. je voudrais être ton mari et qu'ils apprennent tous qu'au moins un homme à petrograd a quelqu'un qui l'aime et qui l'attend.
je joue longuement. violemment. je ne joue même pas bien, j'ai l'impression que je joue comme je bois - plus pour oublier que par réel plaisir. les crins de mon archet finissent même par se détacher, épuisés par la longue course qui les a tenus en haleine pendant plusieurs heures. ce n'est que lorsque j'entends la poignée tourner que je cesse. je me retourne et te découvre, fatiguée. tu me souris et ouvre grand tes bras, je laisse tout tomber pour te rendre ton étreinte, dénouer le foulard blanc, retirer le manteau qui fait s'affaisser tes frêles épaules. t'apporter un verre d'eau et te demander si ça va. puis je n'y tiens plus, je prends ton visage dans mes mains, laisse mes pouces caresser tes joues, mes doigts parcourir la courbe de ta nuque, les mèches perdues entre mes phalanges. j’embrasse les tâches de rousseur sous tes yeux, une fois, deux fois, puis j’arrête de compter. tes yeux se ferment et je les embrasse aussi, je t’embrasse partout. je presse mon front contre le tien,
comment pourrais-je un jour douter de toi ?
- notes de bas de page:
2. Saint-Pétersbourg fut renommée Petrograd en 1914 pour adopter un nom qui sonnait plus russe et ainsi lutter contre la suprématie allemande. Elle fut le théâtre de la révolution russe jusqu'à ce que Lénine déplace la capitale à Moscou. Elle fut renommée Leningrad à la mort de celui-ci, en 1924, pour retrouver son ancien nom, Saint-Pétersbourg, suite à un referendum en 1991.
3. 9000 roubles équivalent à une centaine d'euros.

 Accueil
Accueil